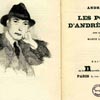Fonds Rivière-Fournier : la Nouvelle Revue Française

Dans les premières années du 20e siècle, marquées par le second procès de Dreyfus en 1899 et les déchirements entre catholiques et laïcs (loi de 1905 de séparation entre les églises et l’état), quelques personnages dominent le paysage littéraire français parmi lesquels Anatole France, Paul Bourget, Pierre Loti, Maurice Barrès, et à part, chacun dans son genre, Edmond Rostand et Charles Péguy.
Cependant, des mouvements nés au siècle précédent se meurent (naturalisme, Le Parnasse) ou s’essoufflent (le symbolisme perd ses revues majeures entre 1903 et 1906). Des écrivains néoclassiques, antiromantiques et hellénisants se retrouvent dans la revue L’Action française qui prône la politique d’abord, d’autres, antinaturalistes participent à La Revue des Deux mondes.
D’autres revues circulent, que lisent avec passion Rivière et Fournier : L’Ermitage, symboliste ; Vers et Prose, qui se double de soirées organisées par Paul Fort et Jean Moréas où se croise une partie, un peu fanée ?, du milieu littéraire, Le Mercure de France, solidement établi, L’Occident (1901-1914) qui publie Claudel, Suarès, où Maurice Denis tient une rubrique d’art. C’est là que Rivière publie d’abord tandis que Fournier débute dans La Grande Revue.
Des petits groupes comme celui de Carnetin avec Marguerite Audoux, Michel Iehl, Charles-Louis Philippe rassemblent aussi des auteurs par affinités dans une recherche d’échanges humains.
C’est alors qu’autour de Gide, qui rêvait depuis ses vingt ans à la « revue future », se cristallise l’idée d’une publication, simplement appelée La Nouvelle Revue Française ; Michel Drouin, André Ruyters, Henri Ghéon, Jean Schlumberger, Jacques Copeau et Gide rejettent l’impressionnisme, ont « soif de sobriété, horreur de la mode, haine du clinquant, souci de la réalité, de l’austérité » (Jean Lacouture).
« Tous étaient nés dans le Symbolisme et y avaient fait leurs premières armes… Ils se sentaient ramenés vers les formes plus objectives et plus vivantes du roman et du théâtre… En toute œuvre, ils ne voulaient voir que sa force, que son poids, que sa réalité esthétique ». (Jacques Rivière). « La seule [matière] dont nous nous sentions capables de faire quelque chose, c’est cette matière toujours neuve et palpitante : l’homme » (Jacques Copeau).
Après un faux départ fin 1908, le premier numéro paraît le 1er février 1909. Dès avril, Jacques Rivière y contribue et côtoie ainsi les fondateurs ainsi que Charles-Louis Philippe, André Suarès, Léon-Paul Fargue, Alexis Léger bientôt Saint John Perse, Claudel, …
En 1911, il devient secrétaire de la revue où paraît en livraisons Le Grand Meaulnes de juin à novembre 1913.
La Guerre interrompt la parution de La N.R.F. Elle reprend en juin 1919 sous la direction de Jacques Rivière qui donne toute sa mesure dans ce rôle fin et délicat, certainement au détriment de son œuvre personnelle. Il est alors en correspondance avec nombre d’écrivains qu’il encourage, stimule, houspille aimablement, ramène vers la revue (Proust), tient à distance (Artaud)…
A sa mort le 14 février 1925, son assistant Jean Paulhan lui succède.
Après les années sombres de la Seconde guerre mondiale, la publication reprend en 1953 sous le titre temporaire La Nouvelle Revue Française. Elle cesse d’être mensuelle et devient trimestrielle en 1999.