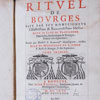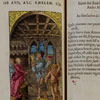Histoire de la bibliothèque
A Bourges comme dans nombre d’autres villes, l’histoire publique de la bibliothèque commence avec la Révolution Française. Bien sûr, des bibliothèques existaient avant cela, et elles ont alimenté ce qui, en 1806, au terme de quelques péripéties assez peu glorieuses, deviendrait pour finir la bibliothèque municipale de Bourges.
Les livres saisis proviennent de grands établissements religieux, principalement : l’abbaye bénédictine de Saint-Sulpice de Bourges, celles de Chezal-Benoît et Saint Cyran en Brenne (dont les bibliothèques étaient revenues à la première), l’archevêché et le chapitre de la cathédrale, le collège des Jésuites.
A partir de 1791, ces livres ont été réunis et répartis dans quatre dépôts (le palais archiépiscopal, l’actuelle préfecture alors intendance, le séminaire, aujourd’hui centre Condé, et le collège, de nos jours école des Beaux-Arts).
On peut dire que commence là l’histoire sombre de ces bibliothèques peinant à être reconstituées en une collection et un établissement dignes de ce nom. Leur dispersion en quatre lieux, s’ajoutant à la quantité assez considérable de quelque 60 000 volumes confisqués, ont eu pour effet qu’il a fallu des années avant que les livres soient rassemblés en un seul endroit et décrits de façon cohérente dans un catalogue. De plus longues années encore ont été nécessaires pour qu’ils soient physiquement mis à l’abri dans un bâtiment unique dévolu à cette fonction. Celui-ci ne pouvait exister avant les événements qui l’avaient rendu nécessaire, et aucun des bâtiments existants, y compris ceux qui finirent par recevoir les livres, n’y étaient adaptés.
Dans cet ensemble de livres mal structuré et mal logé, ce qui avait statut de bibliothèque de département, alimenta pour dix ans, entre décembre 1794 et 1804, une seconde bibliothèque, celle de l’école centrale, ceci sans que les deux bibliothèques soient installées dans des locaux différents.
En 1806, la bibliothèque départementale devenue municipale, ce sont les bâtiments de l’archevêché qui furent choisis pour y déposer les livres. Il fallut plus de dix ans pour que tous y soient effectivement transférés.
La dispersion des lieux a favorisé les vols. L’inappropriation des locaux étant synonyme d’une profonde insalubrité combinant saleté, souillure par la fumée, humidité, moisissures, présence consécutive de vermine et rongeurs, nombre de livres ont été profondément et irrémédiablement endommagés, sans compter ceux qui ont simplement été détruits et perdus pour toujours.
A ce sombre tableau il faut encore ajouter des accidents survenus aux bâtiments. Dans un des dépôts contenant encore des livres, une tour s’est effondrée, les ensevelissant (certains de ceux encore présents à la bibliothèque portent des traces de gravats qui vraisemblablement en sont la conséquence). Surtout, en juillet 1871 un incendie a frappé l’archevêché où les livres étaient déposés. Il semble que le plus grand nombre a été sauvé, mais beaucoup ont été mouillés, et à la suite, ils ont été entreposés dans l’urgence à la cathédrale et chez quelques particuliers, se trouvant encore une fois en proie aux moisissures et aussi aux convoitises humaines, dont attestent les écarts entre les inventaires anciens et ceux que nous pouvons faire aujourd’hui, sans qu’il paraisse entièrement raisonnable d’imputer au feu un goût tout particulier pour les éditions rares.
Beaucoup des livres aujourd’hui présents dans le fonds patrimonial de la bibliothèque portent donc les stigmates de cette période fâcheuse de leur bien plus longue histoire.
Ce premier logement détruit par le feu, en 1873 les livres de la bibliothèque municipale ont été installés dans un hôtel particulier aujourd’hui disparu, l’hôtel Aubertot, alors situé où se trouve le bâtiment actuel de la poste. Bien entendu il n’était pas conçu pour cet usage, et sans aménagements pour l’y adapter, s’est avéré incommode, trop exigu, et surtout difficile à entretenir. La saleté, les parasites et les champignons sont donc demeurés de mise.
En 1964, un autre hôtel particulier du centre ville, légué à cette fin par la veuve du docteur en médecine Daniel Témoin, a reçu la bibliothèque après avoir été adapté à cet usage, par la construction d’un magasin à livres et l’aménagement de salles destinées à accueillir les lecteurs. Les collections patrimoniales et d’étude s’y trouvent aujourd’hui encore.
Bien entendu, à partir de 1964, à Bourges comme en d’autres villes françaises à la même époque, les bâtiments et les collections écrivent par leur évolution une seconde histoire, écho d’un phénomène international. Une nouvelle attention politique est portée à la demande d’un public élargi et croissant d’accéder à la lecture, puis à d’autres ressources : musicales, filmiques, informatiques. Une sociabilité nouvelle s’organise, ancrée sur le goût et le désir de découverte et d’échange que ces ressources largement accessibles inspirent diversement à chacun.
C’est ainsi qu’en 1972, une bibliothèque a vu le jour dans le quartier des Gibjoncs, qu’une médiathèque a été inaugurée en 1994, et que depuis 1991 une seconde bibliothèque de quartier, située auprès du centre commercial du Val d’Auron, accueille les jeunes lecteurs et les amateurs de musique.
On soulignera pour finir que les violences d’une guerre ou d’une révolution ne sont pas nécessaires à la mise à mal d’une bibliothèque prestigieuse. L’histoire berruyère en fournit un autre exemple, et non des moindres, puisqu’il s’agit de celle de la Sainte Chapelle du Duc Jean de Berry, réduite au début du XVIIIe siècle à un état d’abandon aussi difficilement imaginable qu’effectivement constaté : les salles constituées en bibliothèque, où les livres étaient toujours, y compris pour certains sur des pupitres, avait été transformées en poulailler.
Au-delà de l’anecdotique intérêt de la chronique, ces faits ont un sens méritant qu’on s’y arrête. Des siècles d’attention, secondés par le souci passionné de quelques collectionneurs éclairés ont construit les bibliothèques devenues propriété de la Nation, puis confiées au soin de la municipalité. Elles avaient ainsi perduré et grandi au fil des générations. En regard, quelques dizaines d’années d’incurie ont suffit à y occasionner des dégâts profonds et des pertes irrémédiables. Conscients de cela et instruits par les faits, nous apportons désormais la plus grande attention à leur conservation, à leur enrichissement, et à leur transmission.